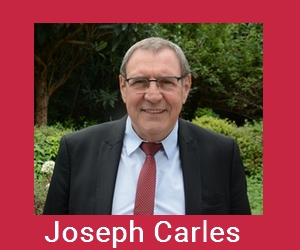L’action publique qui était le cauchemar des tenants de l’ultra libéralisme, et la hantise des économistes « mainstream », retrouve aujourd’hui des vertus. Nombre de cadres dirigeants d’entreprises antérieurement très prompts à dénoncer l’augmentation des impôts, le niveau de la dépense publique, la mauvaise utilisation de l’argent public, l’irresponsabilité des fonctionnaires, se réjouissent aujourd’hui de voir l’État mettre en place le chômage partiel, de constater que les collectivités territoriales proposent des aides pour la sauvegarde des savoirs-faire de nos entreprises de toutes les tailles.
La réhabilitation de l’action publique est ainsi le premier enseignement que l’on peut tirer de cette crise.
Ce renouveau doit être regardé à travers trois prismes : l’action publique comme amortisseur social, l’action publique comme levier de relance de l’activité productive et de service, l’action publique comme outil de régulation du marché.
L’ACTION PUBLIQUE COMME AMORTISSEUR SOCIAL
Dans toutes les crises, c’est la population la plus fragile, la population la plus exposée qui est la plus impactée. Mais la crise que nous connaissons présente aussi la caractéristique de faire rentrer des populations nouvelles dans le champ de la paupérisation. Certains commerçants, artisans, ou professionnels libéraux, des intermittents du spectacle et autres artistes, mais aussi des cadres moyens et supérieurs vont désormais rejoindre le bataillon des oubliés de la crise. Notre système de santé a permis de prendre en charge tous les patients sans s’interroger sur leurs capacités financières. L’hommage rendu tous les soirs du 1er confinement aux soignants par la France d’en-bas, les témoignages de sympathie et de reconnaissance de la France d’en haut et même de la stratosphère des très hauts revenus, témoigne de l’attachement de la nation à son système de santé. Ceux qui il y a quelques semaines encore dénonçaient le déficit de l’assurance maladie sur les plateaux de télévision encouragés par les journalistes bienpensants sont devenus muets sur ce sujet. Je ne doute pas qu’ils seront prompts à reprendre la parole quand le virus ne circulera plus comme ils ont salué en d’autres temps la suppression de milliers de lits hospitaliers et la fermeture de services de soin.
Notre système de protection sociale souvent critiqué parce que trop ouvert trouve aujourd’hui toute sa justification. On a accepté en France que des citoyens renoncent aux soins pour des raisons financières. Mais aujourd’hui encore plus qu’hier nous devons constater que des habitants doivent se limiter à un seul repas par jour et cela est vrai aussi pour des enfants. Les organisations caritatives ne vont plus arriver à assumer une demande en croissance constante.
Cette crise va marquer un tournant dans la mise en œuvre de la protection sociale dans le débat sur l’instauration d’un revenu universel minimum qui n’est plus un sujet tabou. Il témoigne de la profondeur des questions qui devront être discutées. La solidarité devra connaître une nouvelle dimension et les revenus de certains de nos concitoyens devront aussi être revus à l’aune d’une nouvelle donne sociale. La question d’une autre répartition de la richesse ne pourra pas être occultée.
L’ACTION PUBLIQUE COMME LEVIER DE RELANCE ÉCONOMIQUE
Comme en 2008 lors de la crise des subprimes, les économistes y compris les inconditionnels du marché redécouvrent la pertinence des politiques keynésiennes Ces politiques sont qualifiées de contra-cycliques. En période de crise, la puissance publique s’endette pour soutenir les entreprises à vocation stratégique ou qui ont un rôle de locomotive, et engager des dépenses publiques pour assurer la « relance de la machine ». Le remboursement de l’endettement très important des États suscite des commentaires très différents.
La crise économique ayant un caractère mondial, c’est la conception même de la finance qui doit être revisitée. Les vieux réflexes des investisseurs spéculateurs ont ressurgi à l’annonce d’un vaccin.
Cette question est centrale car ceux qui profitent de la finance sont naturellement enclins à défendre le modèle existant. Pourtant de plus en plus d’économistes y compris dans les rangs des « orthodoxes » plaident pour un autre traitement des dettes publiques. Certains proposent un allongement très significatif de la dette au-delà de 60 ans, d’autres plus radicaux envisagent l’effacement de la dette des banques centrales. Ces décisions sont d’abord et exclusivement politiques. La réticence d’autres économistes est justifiée par le risque de perte de confiance des investisseurs. Mais en période de sur-liquidité ils n’auront pas d’autre choix que d’accompagner la relance économique pour recréer des investissements rémunérateurs. Le prix à payer pour relancer la machine c’est de sacrifier une partie de son épargne pour assurer une activité qui permettra de la reconstituer.
En effet pour assurer une relance il faut que l’outil de production soit préservé, notamment le savoir-faire et l’expertise des salariés, mais aussi que la structuration des entreprises demeure. C’est pour cela que l’État propose des aides aux entreprises d’une part, un soutien aux salariés d’autre part pour préserver l’outil de production. C’est le sens de la mise en place des mesures de chômage partiel qui ont un effet social mais qui permettent aussi aux entreprises de préserver leur capacité de production.
Au-delà de la relance par la commande publique, les États peuvent aussi être amenés à recapitaliser des entreprises dont l’activité est stratégique. La question d’Airbus, celle d’Air France KLM par exemple est ainsi posée et la question d’une augmentation de capital souscrite par les États Européens est ouverte, même si cette prise de majorité par des acteurs publics devra être adaptée au nouvel ordre économique lors de la reprise des activités qui devra sans aucun doute consacrer la suprématie de la coopération sur la compétition.
L’ACTION PUBLIQUE COMME système de régulation
La crise met en évidence les dérives d’un marché débridé dont le seul moteur est celui de la spéculation qui consacre ainsi le « triomphe de la cupidité » comme l’a parfaitement décrit Joseph Stiglitz. Le scandale du prix des masques, les défauts d’approvisionnement, comme celui des autres matériels absolument indispensables à la protection des soignants mettent clairement en évidence la nécessité de réguler un marché insolent. Il faut ainsi, lorsque c’est nécessaire, ne pas laisser jouer la concurrence et abandonner le concept de loi de l’offre et de la demande dans les domaines indispensables à la vie de la nation. Cette question se posera pour le vaccin.
Cette crise nous apprend que tous les produits, tous les services, ne doivent pas dépendre du marché, mais que certains d’entre eux doivent être fixés par l’autorité publique contrairement à l’idée des dirigeants européens qui voudraient que tous les biens et services relèvent d’un marché libre comme le préconisait la directive Bolkestein.
Pourtant, personne en France ne remet en question la tarification des visites chez le médecin, ou celle du prix du gaz. La question du logement pour tous va nécessairement passer par l’interdiction de la spéculation foncière, par la fixation du prix de cession des terrains et des constructions, car c’est bien le prix du foncier qui bloque aujourd’hui l’accès au logement.
Cette crise nous apprend qu’il conviendra désormais de définir ce qui peut être librement négocié sur un marché et les produits et services réglementés dont le prix sera fixé par les autorités publiques. Déjà Henry Laborit nous avait alertés sur le risque du tout marché :
« Les marchands n’ont pas été chassés du temple, ils sont en train de l’envahir complètement et d’installer leurs boutiques et leurs panneaux publicitaires au plus profond de nos neurones si nous n’y prenons garde »
La régulation ne doit pas s’arrêter au marché des biens et services, elle doit aussi concerner le marché du travail. La crise que nous sommes en train de traverser nous enseigne aussi que des métiers souvent peu considérés, comme celui de caissière de supermarché, d’agent de propreté, de garde d’enfants, naturellement les métiers de l’agriculture et du maraichage, et bien sûr tous les métiers de la santé sont des métiers indispensables au fonctionnement de nos sociétés. Le plafonnement des rémunérations est donc un champ à explorer pour assurer une capacité au vivre ensemble. Il serait ainsi très intéressant de créer une sorte de fonds de péréquation des revenus des artistes et animateurs pour assurer une rémunération décente aux intermittents du spectacle qui leur permettent de briller dans leur art. De même dans les entreprises, on pourrait imaginer la détermination de la masse salariale maximale et de fixer les critères de répartition de celle-ci. La question centrale sera aussi celle du plafonnement des dividendes en lien avec l’endettement des entreprises. La rémunération du risque des investisseurs doit être réelle et tous les instruments visant à réduire ce risque devraient être abandonnés pour inciter les porteurs de capital à abonder une épargne peu risquée, mais moins rémunérée déclenchant un changement de pratiques de financement de l’économie réelle.