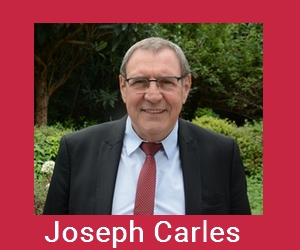Pourquoi avec un taux d’endettement aussi élevé les investisseurs continuent-ils à prêter à la France ?
En 1995, j’avais commis un essai[1] dans lequel je comparais l’endettement des ménages, des entreprises, des collectivités locales et des États. Cette comparaison n’est plus possible aujourd’hui.
En effet lorsqu’un ménage s’adresse à une banque pour demander un prêt, celle-ci mesure son taux d’endettement et si le banquier considère que ce ménage ne sera pas capable de rembourser il refuse le prêt. Pourtant, les banques ou autres organismes financiers, fonds de pension notamment, acceptent de prêter aux états qui apparaissent surendettés en contradiction totale avec la logique du risque.
L’endettement public une réalité inéluctable
Dans un contexte de risque de récession économique, il échoit aux états de relancer la machine économique redonnant une nouvelle jeunesse aux politiques Keynésiennes qui avaient été enterrées par les politiques néolibérales de Margaret Tacher et Ronald Reagan. Ces deux leaders mondiaux, accompagnés par Pinochet au Chili, avaient en effet appliqué quasiment à la lettre les théories de Hayek et Friedman tous deux prix Nobel d’économie. Même si les analyses de ces deux économistes divergent, notamment quant aux causes de la crise de 1929, ils s’inscrivent tous les deux dans la critique de la théorie Keynésienne, les théories monétaristes de Friedman fondant ce que l’on appelle l’école de Chicago.
L’histoire a montré que le néolibéralisme aggravait les inégalités et créait une bulle spéculative mettant gravement en danger les économies mondialisées comme ce fut le cas en 2008 avec la crise des surprimes qui telle un « corona virus financier » a infecté toute la planète.
L’intervention des États paraît indispensable aujourd’hui pour éviter une récession mondiale qui pourrait profiter à la Chine dont dirigeants réalisent leur rêve de « nouvelle route de la soie » que l’on peut traduire en terme stratégique comme hégémonie économique et commerciale en Europe. Cependant cette intervention va entraîner un endettement public qui va s’ajouter aux dettes contractées pour assurer un amortisseur social et notamment la mise en place du chômage partiel ou les aides allouées aux activités paralysées par la crise (restauration, hôtellerie, évènementiel et activités culturelles sous toutes les formes).
Comment les marchés peuvent-ils réagir devant cette situation inédite ?
La logique des investisseurs
L’option des investisseurs pour accepter de financer les États directement ou par les banques interposées repose sur une analyse du risque pays.
L’analyse de l’évolution du concept de risque pays permet finalement d’en dégager la définition suivante. Le risque pays englobe les risques d’ordre macroéconomique, microéconomique, financier, politique, institutionnel, juridique, social, sanitaire, technologique, industriel et climatique susceptibles d’affecter une firme multinationale (FNM), une entreprise exportatrice ou un investisseur en portefeuille dans un pays étranger. Les dommages peuvent se matérialiser de plusieurs façons : pertes financières ; menace pour la sécurité des employés de la société, pour ses clients ou ses consommateurs ; atteinte portée à la réputation ; menace sur un débouché ou une source d’approvisionnement.
Le risque pays est finalement un concept déconcertant et polymorphe. Déconcertant, car quoique relativement récent, il s’articule autour de risques auxquels les investisseurs sont exposés depuis longtemps. Polymorphe, car les risques en question diffèrent sensiblement selon les types d’investisseurs.
Cette double particularité explique que les analyses et diagnostics puissent diverger pour un même pays. Le cas du Japon est, à cet égard, très instructif. Au 9 mars 2015, il faisait partie des 12 États notés A1 par la Coface, mais n’était classé que 27e par une autre agence de notation (avec un score de 67,32 sur 100). La Coface justifiait sa note maximale par le très bon climat des affaires et par un taux de change favorable. Alors qu’Euromoney, en revanche, s’inquiétait du fardeau de la dette publique et des piètres performances macroéconomiques.
La crise requiert l’émergence d’un nouveau paradigme qui sans remettre totalement en cause les principes fondamentaux permette de trouver un dispositif de reprise de l’activité.
La soutenabilité de la dette
Le risque pour un investisseur est lié à l’incapacité d’un créancier à générer un potentiel de création de valeur pour assurer le remboursement. La question de la crédibilité d’un État ne réside donc plus dans la capacité de ses dirigeants à réduire la dette comme cela a été le cas pour la Grèce dans les années 2010, mais bien dans la “capabilité” de créer les conditions d’une reprise de la croissance.
L’enjeu pour l’État n’est donc pas seulement de lancer des grands travaux, mais surtout de favoriser et d’accompagner les entreprises dans leur capacité à rebondir dans des domaines innovants et qui sont en résonance avec les priorités internationales
La France au sein de l’Europe et dans une démarche de coopération avec les pays de l’Union dispose de toutes les compétences pour saisir le rebond qui viendra naturellement après la crise que nous traversons. C’est en tout cas le pari qu’on fait les investisseurs en continuant à prêter à notre pays.
Plusieurs champs méritent d’être explorés qui constituent des leviers de rebond. L’analyse macroéconomique repose historiquement sur la mise en évidence de cycles économiques qui sont au nombre de 4 et qui se succèdent.
La transition écologique
L’économie verte qui reste encore à inventer recèle des gisements de création de valeur extrêmement importants. La question des énergies nouvelles, non polluantes et renouvelables ouvre un champ de recherche et d’innovation qui mérite d’être investi par les laboratoires de recherche européens travaillant en réseau.
La question de l’énergie nucléaire doit aussi être regardée avec pragmatisme. En effet le pari de l’hydrogène est un pari risqué sur le terrain écologique dans la mesure où la production requiert une quantité considérable d’énergie autre, et que les effets de la vapeur d’eau dégagée lors de la combustion n’ont pas encore été parfaitement mesurés quant à leur impact sur la couche d’ozone. La recherche sur le traitement des déchets radioactifs de la production d’énergie atomique est aussi une source de rebond pour l’économie française. La recherche sur les mobilités vertes de l’avion à la voiture sont aussi des leviers de relance essentiels.
La question de l’économie circulaire, celle des circuits courts et de la production bio sont des domaines dans lesquels des laboratoires de recherche publics adossés à des entreprises privées peuvent trouver des pistes pour des activités nouvelles.
La question de la santé
La crise sanitaire que nous traversons nous ramène à l’importance des politiques de santé publique, certes dans la prise en charge, mais aussi dans la recherche de nouvelles thérapies. La vitesse à laquelle les laboratoires ont été en capacité de produire les vaccins contre le corona virus a surpris tout le monde créant d’ailleurs une sorte d’incrédulité sur l’efficacité de ce vaccin et ouvert la porte à toutes sortes de théories complotistes.
Les États ont largement contribué à cette performance, notamment les États-Unis qui ont investi 1 milliard de dollars dans la recherche. Certes aujourd’hui, ce sont les laboratoires privés qui vont réaliser des profits considérables et même indécents au regard de la prise de risque. C’est en effet l’état fédéral, mais aussi les autres pays qui ont assuré le risque les uns en finançant la recherche, les autres en assurant des précommandes sur un vaccin sans savoir s’il obtiendrait les agréments nécessaires. Il serait donc normal que cette prise de risque publique donne lieu à un retour sur investissement public qui pourrait prendre la forme d’un prix du vaccin fixé au niveau mondial par l’OMS (Cette question fera l’objet d’une autre communication).
L’intelligence artificielle
Le demain de l’intelligence artificielle est immense et les laboratoires de recherche français et européens sont en pointe sur ces sujets.
L’économie a d’abord été adossée à la terre quand l’agriculture constituait l’essentiel de la production générant une concurrence féroce dans l’exploitation de celle-ci. Ensuite, c’est l’usine qui a incarné la dynamique économique générant là encore une lutte concurrentielle par les prix ou par l’innovation et la qualité. La guerre économique de demain qui a déjà commencé c’est bien celle de la donnée, celle des data et si les GAFAM se sont bien positionnés, les opérateurs chinois type Huawei sont aussi dans la course.
L’émergence d’un opérateur européen adossé à un marché unique de données est indispensable pour assurer une protection et une exploitation des données stockées.
La production culturelle
La diversité des cultures européennes est un atout déterminant dans l’optique des transformations des modes de vie qui sont en chemin. L’accompagnement de la production culturelle est un vecteur qui peut aussi générer un rebond et générer de la création de valeur.
Cette liste n’est pas exhaustive mais elle permet de mettre en avant la richesse de la France au sein d’une Europe solidaire pour assurer un rebond et une dynamique de développement. Toutes ces opportunités ne pourront être réellement porteuses de dynamique économique et sociale que si elles s’inscrivent dans une démarche de coopération de tous les acteurs.
Une coopération en matière d’innovation au niveau européen pour identifier les centres de recherche les plus avancés en fonction des différents domaines. Cette position doit être accompagnée localement par les collectivités locales, la Région d’abord comme tête de pont mais aussi les intercommunalités et plus précisément les métropoles compte tenu des implantations des centres de recherche universitaires. La déclinaison de l’accueil des entreprises dans les territoires de proximité des villes centre dans le cadre de partenariats est aussi un levier.
En forme de synthèse
Les questions du niveau d’endettement de la France et de la capacité de remboursement de la dette ne peuvent pas être regardées avec les mêmes références que celles qui prévalaient avant la crise sanitaire. Les critères de convergence adoptés lors de la signature du traité européen ont été abandonnés car les États n’ont pas d’autres choix que de continuer à s’endetter.
La question qui se pose aujourd’hui n’est pas tant celle du remboursement que celui de la valeur de cette dette. Comment estimer la valeur réelle et non la valeur faciale de la dette ? Le calcul de la valeur d’un actif dépend de sa rentabilité : avec des intérêts à taux négatifs la dette n’a pas de valeur. Cette valeur dépend aussi du potentiel de revente de cet actif. A qui les investisseurs peuvent-ils vendre une dette qui ne rapporte rien ?
Lorsque les dettes sur les particuliers ou sur les organismes publics avaient de la valeur les créanciers au premier rang desquels les banques pouvaient « titriser » leurs créances en les transformant en valeurs mobilières. Ce fut notamment le cas des créances des banques américaines sur les dettes des ménages qui ont conduit à la contagion de la crise des « subprimes » en 2008, les banques de tous les pays ayant acheté ces titres de créances qui se sont avérés totalement pourris, les ménages américains emprunteurs ne pouvant pas rembourser leurs prêts immobiliers.
Toutes les analyses montrent que nous sommes dans un monde nouveau inconnu et incertain. Face à cette situation nouvelle les concepts ou les outils construits dans le monde d’avant ne sont plus capables d’apporter les réponses aux problématiques nouvelles.
La question de la création de richesse non monétaire liée par exemple à la sauvegarde de la planète, à la capacité à éradiquer les pandémies qui ne manqueront pas de se faire jour, à vaincre le terrorisme et à faire disparaitre tous les intégrismes, à accueillir les flux migratoires climatiques, à anéantir les injustices économiques sont autant de questions sur lesquelles les chercheurs devront se réinventer. Lorsque l’on évoque ces sujets sociétaux, la question de la dette publique apparait comme une péripétie sans grande importance.
Décidément Albert Einstein avait raison lorsqu’il écrivait :
« Si nous ne changeons pas notre façon de penser, nous ne serons pas capables de résoudre les problèmes que nous créons avec nos modes actuels de pensée »
Albert Einstein
[1] J.Carles « Gérer l’endettement » Éditions Liaisons 1995