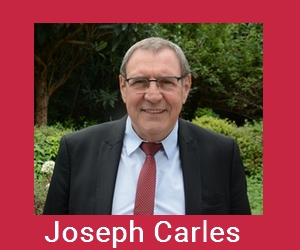La dette publique au sens de Maastricht est la somme de la dette de l’État, des organismes sociaux et des collectivités locales.
Le déficit public est calculé en comparant l’encours de dette au premier janvier d’une année et celui au 31 décembre de la même année. Le déficit n’est donc pas la différence entre les recettes et les dépenses, mais il se calcule par l’augmentation de la dette.
La dette de l’état résulte des émissions d’emprunt par l’État, et ces emprunts sont souscrits par des banques qui utilisent les dépôts de leurs épargnants pour souscrire à ces emprunts. La banque centrale européenne peut aussi souscrire à ces emprunts comme elle l’a fait sur les « emprunts Covid ».
La dette est rapportée au PIB (produit intérieur brut) qui mesure la création de richesse produite dans le pays par les agents économiques. Si la dette progresse au même rythme que la croissance de richesse on peut en conclure que le niveau d’endettement du pays reste inchangé. En revanche, pour la France, l’encours de dette a progressé plus vite que la croissance aggravant fortement le niveau d’endettement. Selon une étude de la banque fédérale de Saint-Louis, en 50 ans le PIB des États-Unis a été multiplié par 21 alors que sur la même période l’endettement a été multiplié par 57. L’endettement a donc progressé 3 fois plus vite que la production de richesse. La question du niveau de la dette ne date donc pas de la crise sanitaire, mais il trouve son origine à la fin des 30 glorieuses avec l’entrée en scène des chocs pétroliers.
Avec la crise sanitaire l’écart entre l’accroissement de la dette et celui de la croissance s’est fortement accru, dans la mesure où cette crise a généré un fort ralentissement de la croissance lié aux confinements successifs et à la mise à l’arrêt de la production et un très important recours à l’emprunt pour assurer un amortisseur social avec notamment la prise en charge du chômage partiel.
L’analyse macroéconomique repose historiquement sur la mise en évidence de cycles économiques qui sont au nombre de 4 et qui se succèdent.
L’expansion
Le cycle de l’expansion est connu comme étant la phase de prospérité. Elle se caractérise par l’augmentation de la production et de la demande sur une courte ou moyenne période, suivie d’un cadre économique solide, puis d’un taux de chômage relativement faible et enfin de l’augmentation du taux de croissance du PIB. Le PIB (produit intérieur brut) est la valeur totale des biens et services produits dans un pays. C’est un indicateur de la situation économique d’un pays.
En d’autres mots, le cycle de l’expansion est la période où il y a le plus de salariés et les investissements sont également très élevés. Cette phase du cycle économique est habituellement accompagnée d’une inflation. L’inflation désigne l’augmentation des prix, y compris celui des matières premières. Le potentiel de la phase d’expansion ne peut être exploité que sur un court terme.
La récession
Cette phase est le début du ralentissement de la production. Après avoir été au summum de son potentiel, l’économie commence à se contracter. Elle continue à croître, mais en faibles proportions. C’est le revirement de l’économie suite un essor considérable.
Après quelques mois de PIB négatif survient la crise économique. C’est la phase négative du cycle économique. Elle se manifeste par une stagnation des activités économiques et une diminution des niveaux et des possibilités d’emploi ainsi que d’une baisse du volume de demande de biens et de services.
Durant cette période les investisseurs évitent les gros placements.
La dépression
C’est le niveau le plus bas du cycle économique, elle se caractérise par une impasse économique, notamment par la stagnation de la productivité, l’accumulation des stocks, la fermeture d’une majorité de PME et PMI (petite ou moyenne entreprise), l’augmentation du taux de chômage, la déflation (baisse des prix) et un taux de PIB négatif. Toutes les institutions financières et économiques sont touchées par la dépression. Cette phase de dépression peut durer longtemps à moins de trouver un nouvel élan pour relancer les activités économiques.
La reprise ou la récupération
Cette phase est l’évolution de la dépression. Elle se dessine suite à des mesures permettant de relancer la productivité et aux marchés de retrouver un nouveau souffle. La reprise se caractérise par une valeur positive du PIB, un accroissement de la consommation, une baisse du taux de chômage, une augmentation du revenu salarial et un redémarrage des investissements
Les politiques proposées par JM Keynes invitent les états à engager des politiques contracycliques afin d’atteindre la phase 4 du cycle.
Ainsi en phase de récession l’État encourage la croissance par une politique de relance qui permet aux entreprises de retrouver de l’activité pour sortir de la crise. Pour financer cette politique, l’État s’endette en formant l’hypothèse que la croissance retrouvée il pourra lever la fiscalité lui permettant de rembourser sa dette. En effet en période de croissance l’État peut réduire ses investissements dans la mesure où les entreprises investissent suffisamment pour assurer la croissance limitant ainsi ses propres besoins de financement.
Cependant la théorie des cycles économiques et les modèles qui en découlent comme celui de la relance par l’investissement public semblent aujourd’hui dépassés et peu pertinents face à une crise sanitaire dont les effets économiques et sociaux ne peuvent pas être encore mesurés.