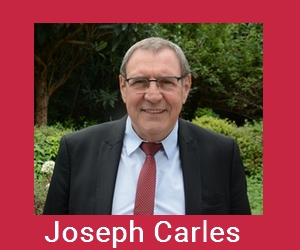Avant la crise sanitaire provoquée par la pandémie du Covid 19, le discours dominant était celui de la réduction des déficits publics et tous les experts bienpensants invitaient le gouvernement à se rapprocher des critères de convergence inscrits dans le traité de Maastricht en limitant la dette de la France à 60% du PIB.
Face aux effets de la crise lors de la première vague et puis de la deuxième vague, ces objectifs ont été abandonnés. La mise en place du chômage partiel, les dispositifs d’aides aux entreprises, le plan de relance ont eu raison de la politique de réduction des déficits.
La France, comme les autres pays développés, a dû se résoudre au « quoi qu’il en coûte » pour amortir les effets économiques et sociaux de la mise à l’arrêt du pays pendant plusieurs mois.
Ainsi la dette publique a atteint 120% du PIB à la fin de l’année 2020, soit le double de ce qui était prévu par le traité européen.
Est-ce grave docteur ?
Les critères de convergence ont été inscrits dans le traité européen signé le 7 février 1992 à Maastricht dans un contexte qui n’est plus celui que nous connaissons aujourd’hui.
En effet dans les années 1990 l’économie mondiale et européenne connaissant un niveau d’investissement élevé alors que l’épargne des ménages évoluait peu.
Ainsi, la capacité globale d’emprunt était limitée. Pour éviter l’effet d’éviction des entreprises demandeuses de prêts pour financer leurs investissements, il a été décidé de limiter la consommation d’emprunts des États, il s’agissait aussi de conserver la capacité de remboursement de la dette. Cette limitation avait enfin comme autre objectif de faire baisser les taux d’intérêts très élevés puisqu’en 1991 le taux d’intérêt légal était supérieur à 10% contre moins de 3% aujourd’hui.
Le contexte actuel présente deux caractéristiques, d’une part le taux d’épargne des ménages est particulièrement élevé ce qui constitue un potentiel de prêt élevé alors que dans le même temps le volume d’investissement privé stagne.
Le niveau d’épargne
En plus des inégalités de revenus qui ont été révélées notamment par Thomas Piketty[1] les incertitudes quant aux conséquences de la crise conduisent les ménages à renforcer leur épargne. Ce phénomène vérifié au niveau mondial est vrai aussi en France. Ainsi, depuis le début de la pandémie le niveau d’épargne a atteint des sommets et cette épargne de précaution a été constituée par des ménages relativement aisés. La crise sanitaire pourrait encore accroître les inégalités et générer plus d’inquiétudes renforçant encore l’engouement pour une épargne de précaution peu risquée même si elle est peu rémunératrice.
Toutefois, même si les « rentiers » voient leur épargne se dévaluer, les plus impactés seront ceux qui perdront du revenu dans des proportions importantes.
L’investissement privé
L’investissement des entreprises stagne depuis plus de 5 ans. Les raisons de cette récession sont multiples. La baisse de la demande d’abord a joué un rôle important mais pas unique cette baisse a été concomitante avec un effondrement du cout de l’énergie et les fortes incertitudes macroéconomiques. D’autres analyses mettent en avant une faible progression du taux de productivité qui avait connu des performances excellentes dans la première décennie 2000.
Le plus inquiétant dans ces facteurs de baisse de l’investissement est celui relatif à l’incertitude des firmes et donc des investisseurs. En effet la crise sanitaire en générant une économie anémiée dans certains secteurs risque de décourager encore plus la prise de risque.
Une situation durable ?
Le contexte que nous venons de décrire a peu de chances d’évoluer à court terme. En effet le niveau des inégalités est tel que des plus aisés ne consommeront pas la totalité de leurs revenus et vont chercher à préserver leurs avoirs. Le vieillissement de la population va aussi générer une augmentation de la capacité d’épargne car ces ménages sont moins consommateurs et psychologiquement prudents s’attachant à renforcer leur épargne de précaution. Les entreprises devront reconstituer leurs fonds propres avant de lancer de nouvelles stratégies d’investissements et l’investissement lié à la transition écologique ne va pas être immédiat.
Il est donc fort probable que l’excédent de liquidités se pérennise alors que les besoins privés ne vont pas décoller de façon rapide. Pire une sorte de spirale de sur-liquidité risque de s’enclencher créant une forte suspicion sur un scénario de reprise de la croissance. Cette idée de reprise de la croissance est d’ailleurs à interroger.
« Celui qui croit en une croissance infinie dans un monde fini, est soit un fou… soit un économiste »
Albert Einstein
La croissance a été réelle pendant les 30 glorieuses, et elle s’est adossée à des gains de productivité exceptionnels. En effet la croissance c’est la différence entre les inputs et les outputs, c’est-à-dire la consommation de moyens nécessaires pour créer de la richesse. Pour simplifier à l’extrême disons que si un ouvrier consacre 10 heures de travail pour produire une chaise et que grâce à une technique nouvelle il produit la même chaise en 5 heures, il y a gains de productivité et croissance puisqu’il produit deux fois plus de richesse. Cet accroissement considérable de productivité généré notamment par l’organisation scientifique du travail (OST) et, chère à Taylor et appliquée par Ford, et les progrès technologiques ont caractérisé la période de sortie de la deuxième guerre et ont réellement créé de la croissance. Il ne peut pas y avoir de croissance réelle sans réduction des inputs pour la réalisation des mêmes outputs. Diverses études menées dans des pays différents mettent en évidence le très fort ralentissement des gains de productivité dénonçant une croissance virtuelle déconnectée de l’économie réelle réduisant l’investissement privé.
L’offre d’emprunts est supérieure à la demande, ce qui produit une baisse jamais connue à ce jour des taux d’intérêts. Les investisseurs se retrouvent ainsi dans une situation telle, qu’ils acceptent des taux négatifs, ce qui signifie qu’ils acceptent d’être moins remboursés à l’échéance que ce qu’ils ont prêté.
« La France a emprunté 9,996 milliards d’euros à long terme jeudi sur les marchés, et a émis pour la première fois à un taux négatif pour son obligation de référence à dix ans, a annoncé l’Agence France Trésor (AFT), chargée de placer la dette française auprès des investisseurs. Sur le marché secondaire, le taux de l’OAT 10 ans est tombé sous zéro pour la première fois le 18 juin dernier. » revue le Revenu 4/07/2019
Toutefois le taux réel reste positif car supérieur au taux d’inflation qui est lui aussi particulièrement faible. C’est dans ce contexte que la question du niveau d’endettement public doit être regardée. La question de cet endettement fait l’objet de débats et plusieurs solutions contradictoires sont avancées entre économistes. Les uns préconisent l’annulation des dettes souveraines, les autres militent pour une intervention de la Banque Centrale Européenne et une mutualisation de la dette des pays européens, d’autres enfin préfèrent le statu quo et un remboursement classique.
Cette confusion est alimentée par les journalistes, authentiques Diafoirus, qui viennent chacun à leur tour nous expliquer sur fonds de catastrophe mais sur un ton péremptoire ce qui va arriver
Cependant la plupart des observateurs initiés s’accordent à considérer que la dette souveraine est une dette perpétuelle qui ne dit pas son nom, et personne n’envisage un État à zéro dette. Cela serait d’ailleurs une ineptie car il ne faut jamais oublier que c’est la dette qui assure la solidarité entre les générations. En effet, les investissements publics sont utilisés par toutes les générations et il est donc normal que chaque génération participe au financement de ces équipements mais aussi des investissements immatériels comme la formation, la recherche et bien sûr la santé. Ceux qui critiquent le fait que nous laissons le poids de la dette à nos enfants oublient deux choses. D’abord que nos parents nous ont laissé aussi le poids de la dette puisque celle-ci est perpétuelle, ensuite qu’en nous laissant la dette ils nous ont aussi laissé tous les moyens d’y faire face en assurant notre éducation, notre formation et en mettant à notre disposition les équipements nécessaires. C’est ce que nous faisons avec nos enfants en adaptant les dispositifs à l’évolution de la société.
Cet article n’a pas la prétention de proposer LA solution, mais plus humblement d’analyser chacune des préconisations en essayant de mesurer leur impact.
[1] Thomas Piketty “le capitalisme au 21émé siècle”